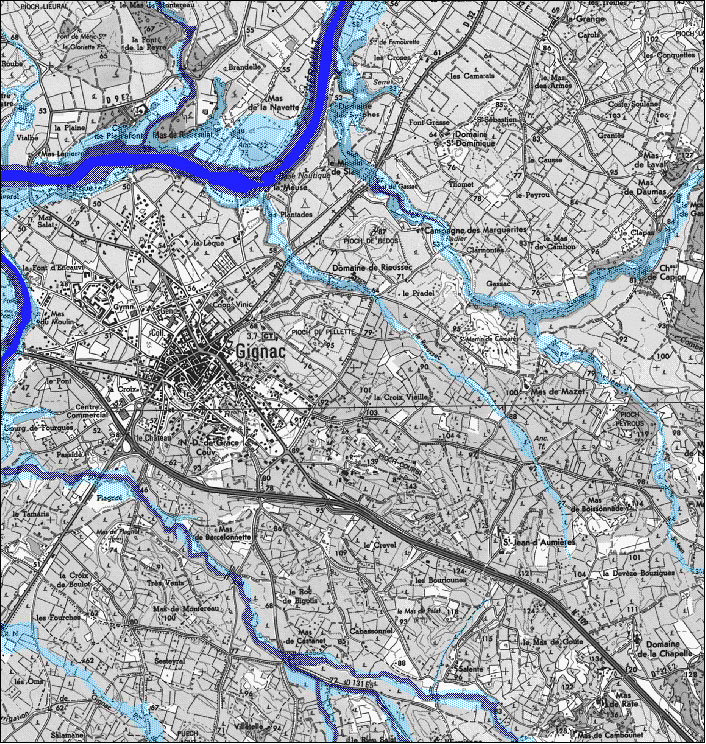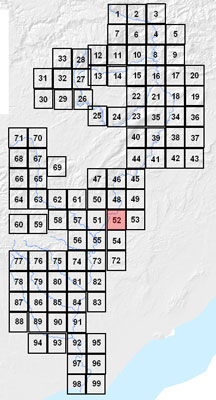DALLE N°52
Communes : Gignac,
Lagamas
Cours d'eau : l'Hérault
Commentaire sur la zone : Au droit du
pont du diable, le cours d'eau pénètre dans sa vaste
plaine alluviale. Cette dernière s'est façonnée
tout au long du Quaternaire suivant les grandes alternances entre
les périodes
froides et chaudes qui se sont traduites par un cycle de
phases d'incision et de comblement successif de la vallée.
Cette période est caractérisée par une instabilité morphodynamique
et une grande activité érosive. L'ultime glaciation
de cette période, nommée Würm, a façonné la
vallée de l'Hérault. Les témoignages de cette
période froide sont encore visibles de nos jours sous la
forme de terrasses alluviales. A la fin de cette période
glaciaire, la vallée tend à se stabiliser pour adopter
la configuration qu'on lui connaît. Sur le terrain, les différentes étapes
de l'édification de cette vallée sont identifiables
par l'étagement successif des différentes terrasses
alluviales, vestiges de l'ancien dynamisme du cours d'eau.
Sur le linéaire concerné, le cours d'eau est encaissé ayant
comme rempart des terrasses alluviales anciennes de plusieurs mètres
de haut. Néanmoins, en opposition avec le secteur amont,
les éléments constituant la plaine alluviale tendent à se
structurer. L'Hérault s'incise dans sa plaine alluviale de
façon linéaire et uniforme. Le côté chaotique
des gorges est délaissé au profit d'un hydrodynamisme
moins tumultueux.
Dans cette portion du cours d'eau, la distinction entre les différents
lits constituant le plancher alluvial est nettement visible. Le
lit mineur est large, bordé de talus facilement identifiables.
Le lit d'étiage et le lit mineur sont confondus du fait de
la présence de deux barrages dans le secteur d'étude
(Barrage en amont
de Gignac au lieu-dit "la Meuse" et le seuil du lieu dit
du "Domaine de Carabotte"), générant une
remontée de la ligne d'eau vers l'amont. Hormis ces ouvrages
qui influencent le comportement de la rivière, le lit mineur
se présente tel une zone de dépôts accueillant
la charge solide excédentaire.
Cette zone de stockage temporaire se matérialise par la présence
de bancs d'atterrissements sur les bords ou au centre du lit
d'étiage,
formant de petites îles éphémères dépourvues
de végétation. Ces plages de galets en bordure permettent
la transition avec le lit moyen. Ce dernier est marqué par
une ripisylve dense sur une majeure partie de son
tracé. Il est localement utilisé par
le cours d'eau comme zone de dépôts du transport solide,
notamment dans le secteur amont à la sortie des gorges et
dans les rives convexes des méandres. Ses dimensions sont
réduites compte tenu de la configuration étroite et
profonde de la plaine alluviale active.
Le lit majeur reste le secteur où se concentrent les activités
humaines, majoritairement l'agriculture et localement des zones
d'extraction de matériaux. Perchés au-dessus des deux
autres lits de l'Hérault, les talus externes de la zone inondable
viennent s'adosser aux terrasses alluviales. Le lit majeur a
tendance,
compte tenu de la diminution globale de la pente, à s'élargir.
Les élargissements de ce dernier sur certains secteurs (lieu
dit de la "Meuse", de la "grange Heulz" et du "Grand
Bosc") peuvent être mis en relation avec des activités
d'extraction. Ces zones d'activités viennent grignoter progressivement
les terrasses alluviales.
Dans ce cas de figure, les limites géomorphologiques ne sont
plus identifiables et le principe de précaution nécessite
d'englober les zones de déblais dans le lit majeur. De plus,
ces secteurs d'extraction sont compartimentés et entraînent
des phénomènes de vases communicants entre chaque
zone d'exploitation.
Depuis la sortie des gorges jusqu'à la confluence
avec Lergue, les enjeux sur le secteur restent ponctuels. Sur ce
linéaire
on retrouve quelques fermes en limite de zone inondable. Les
gravières
sont nombreuses et peuvent, elles aussi, présenter des risques
en cas d'inondation en fonction de l'état de leur exploitation.
Quant aux ouvrages, localisés en travers du cours d'eau ou
en bordure directe, ils sont soumis aux phénomènes
d'érosion latérale et d'obstruction en cas d'embâcle
avec un risque de rupture. Les enjeux se quantifient en terme de
coût sur ces infrastructures. Les zones à enjeux, depuis
l'amont, sont les suivantes :
•
La gravière au lieu dit "le Mas Girard"
•
La gravière au lieu dit "le Mas des Carottes"
•
Le "Moulin de l'Hérault"
•
Le camping au lieu dit "la source St-Pierre"
•
La maison au lieu dit du "Mas de la Navette"
•
Le secteur de la "Barque" et du "Mas Lapierre"
•
La gravière au lieu dit "Riveral"
•
Le domaine de "Carabotte"
• La Grange Heulz
•
La gravière du lieu dit "Grand Bosc".
Tous ces secteurs présentent un risque face aux inondations.
Il faut ajouter les infrastructures routières et les ouvrages
hydrauliques, ainsi que les secteurs de déblais abandonnés.
Ces derniers sont reportés sur la carte hydrogéomorphologique
et ont une influence sur le comportement du cours d'eau en
crue.
|
|




![]() Cartes
1/25000°
Cartes
1/25000°![]() Cartes 1/10000°
Cartes 1/10000°![]() L'étude
L'étude![]() LEGENDE
LEGENDE